Fiche de lecture "LES ETATS LIMITES/ QUELLES LIMITES ? " 1999, Catherine Chabert, Petite bibliothèque de psychanalyse, Puf
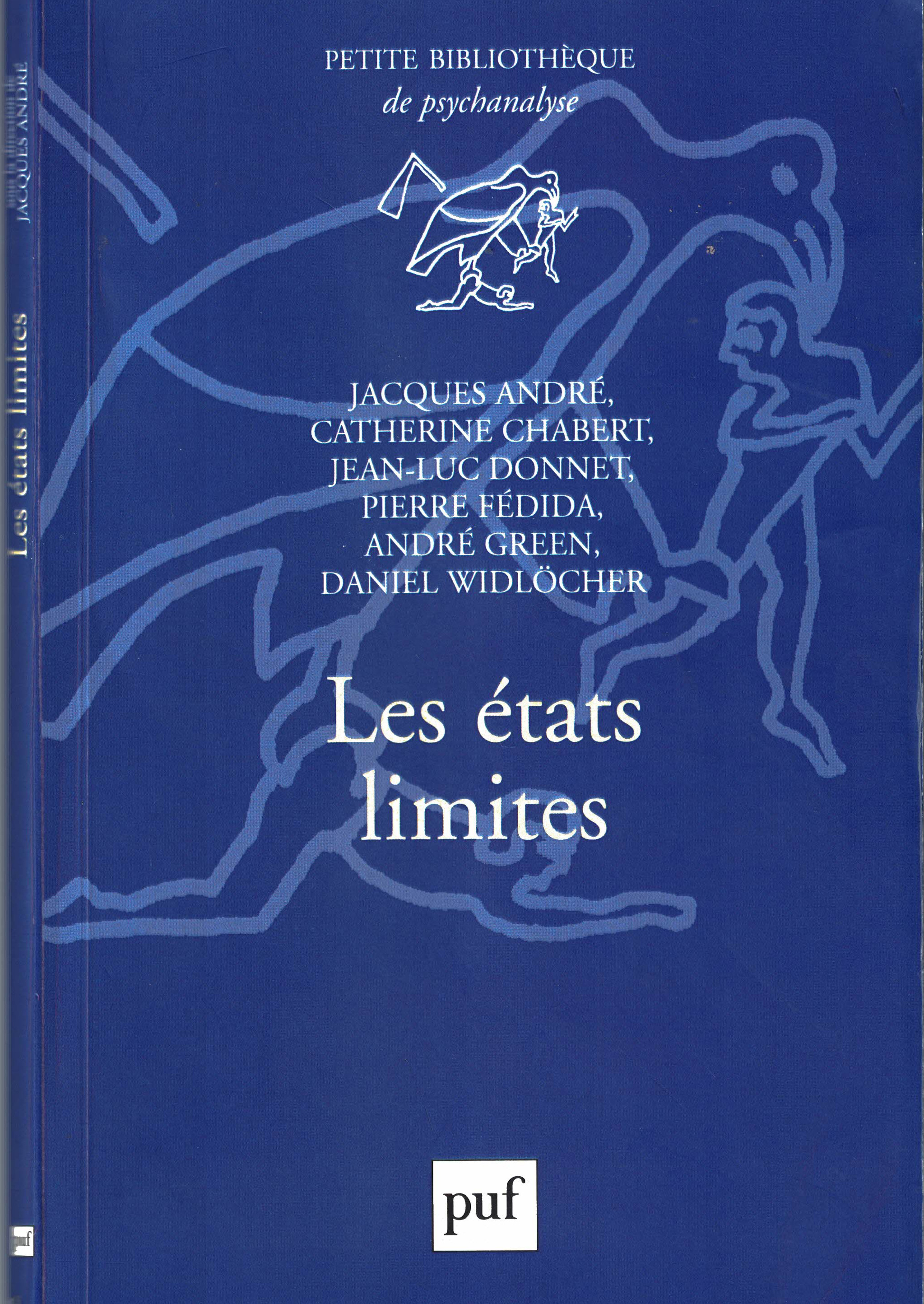
La problématique de la perte d'objet
Tout sujet est confronté lors de son développement et de sa vie à la présence et à la perte de l’objet et aux représentations qu’il en fait. La relation à l’objet est d’une part tournée vers soi par des investissements narcissiques et d’autre part tournée vers l’extérieur, c’est-à-dire poussée par des pulsions du moi et des pulsions sexuelles. Il existe un champ qui permet le passage entre l’intérieur et l’extérieur. C’est cette limite qui est l’espace d’élaboration psychique que Winnicott va signifier comme « le passage de la relation d’objet à l’utilisation d’objet qui implique que le sujet détruise fantasmatiquement l’objet et que celui-ci survive à cette destruction fantasmatique ».Est-ce qu’il s’agit de détruire fantasmatiquement l’objet pour que le sujet apparaisse ? C’est ce qui pourrait être compris lorsque Catherine Chabert écrit « l’appartenance à l’un ou à l’autre ne pose plus question parce que l’aire intermédiaire se déploie entre eux deux. »C’est le sens donné à l’affect qui va permettre une représentation, une élaboration. L’absence de sens conduit l’affect à une absence de représentation et donc à une douleur qui rappelle le manque, la perte, le manque de soi. C’est bien en ce sens que la problématique dépressive chez les états limite se trouve dans la perte de l’autre, l’absence de l’autre, l’absence de la représentation des affects qui sont liés à l’absence de l’autre. On assiste là à une absence d’individuation, donc de capacité à symboliser le retour de l’autre absent.Il s’agit davantage de la capacité à se séparer psychiquement de l’autre, c’est bien ce qui crée cette dépression. M. Klein voyait juste avec cette période de phantasme d’engloutissement. Englouti dans l’absence de l’autre dont le sujet n’est pas individué, donc englouti dans l’absence de soi.Le premier point développé par C. Chabert est le processus qui associe représentations et affects. C’est-à-dire « l’opération qui consiste à reconnaître en soi la valeur de l’émotion et affect susceptible de prendre, valeur positive ou négative, ou en termes de plaisir et déplaisir par sa liaison avec la représentation d’un objet présent/absent. Opération fondamentale sinon fondatrice qui apparaît régulière et inopérante ou inaccessible chez les patients états limites. »
Concernant le contre-investissement, en référence au dictionnaire Laplanche et Pontalis, il s’agit pour l’état limite de lutter contre l’absence de l’objet en refoulant l’absence et en maintenant l’illusion de la présence de l’objet. Nous sommes bien ici dans la non-acceptation de l’absence, absence qui est refoulée dans l’inconscient, avec la persistance de l’illusion de la présence à laquelle l’état limite reste attaché, dépendant. Il s’agit de l’incapacité à se détacher, à s’individuer de l’objet absent. Le contre-investissement donne une action de dépendance à l’objet absent et c’est bien la dépendance qui fait surgir l’objet dans la réalité interne du sujet. L’idée principale du contre-investissement est de maintenir le refoulement. L’état limite est dans un contre-investissement de l’absence de l’objet qui conduit au déni de la réalité extérieur. (Dictionnaire Laplanche et Pontalis).L’état limite est bien sous l’emprise d’une aliénation à l’objet présent/absent directement lié au narcissisme (primaire) du sujet. Le monde extérieur vient suppléer pour lutter contre l’angoisse dépressive.Il vit dans la subjectivité de ses affects. C’est-à-dire vécu de manière confuse, refoulée, et compensée par une dépendance à la réalité extérieure. Le double effet de la douleur interne de l’état limite est de vivre caché. Faisant référence à Winnicott, C. Chabert cite « Vivre caché est une joie mais c’est une catastrophe de ne pas être trouvé » (1971, p131). Je peux dire cacher la perte de soi au risque de se perdre. Tout est ici l’affaire de la subjectivité des affects de l’état limite. La non-acceptation par manque narcissique implique la compensation, l’investissement d’un objet extérieur pour maintenir refoulé ce qui est ressenti confusément.
L’amour et la haine
Rappelons que c’est la capacité du sujet d’associer à la fois le bon et le mauvais chez le même objet qui confère au sujet sa capacité d’ambivalence des sentiments et donc la capacité d’associer l’amour et la haine.L’état limite est dans le clivage, donc de son incapacité d’accès à son sentiment d’acceptation d’ambivalence qui réfère à la position schizoparanoïde. Par conséquent s’agirait-il de travailler en psychothérapie la capacité d’ambivalence du sujet état limite, c’est-à-dire sa capacité à accepter d’une part que ses propres sentiments de haine et d’amour puissent exister vers un même objet, et d’autre part qu’un même objet peut être à la fois bon et mauvais ? Alors que la capacité d’ambivalence des sentiments chez un même sujet va se consolider à l’Œdipe, C. Chabert écrit que le clivage persiste à ce stade, c’est-à-dire la haine pour l’un et l’amour pour l’autre. Il y a incapacité à lier les deux. En ce sens voilà une seconde étape thérapeutique pour développer la capacité d’ambivalence chez le sujet et l’aider à sortir de son clivage. Serait-ce alors partir de soi pour aller vers l’autre ? Serait-ce la capacité d’assembler pour créer autre chose qui aurait un sens nouveau ? Par le clivage, l’état limite va dépenser une énergie considérable à faire fonctionner sa pulsion de haine. C’est par ce fait que l’objet existe pour l’état limite je prends/je rejette, j’aime/j’aime plus, fonctionnement qu’on retrouve à l’Œdipe chez ce sujet.La haine chez l’état limite se forge comme un système défensif qui est nécessaire pour effectuer la séparation, la différenciation, pour ne pas se laisser envahir par l’autre et succomber à la tentation de la dépendance. Il faut noter l’importance de l’autre comme objet qui existe et a toute son importance pour l’état limite. C. Chabert écrit « L’hostilité vis-à-vis de l’autre masque, non pas l’amour pour lui, mais la peur de le perdre. » Ce mécanisme destructif, d’hostilité, œuvre comme une mesure de protection narcissique par rapport à la crainte d’abandon. Les mouvements masochiques, ou retournement contre soi, sont ici à l’œuvre chez l’état limite par la haine et la destructivité de soi.Nous avons vu jusqu’à présent le clivage, le déni, la haine comme faisant exister nécessairement l’autre. Le prochain mécanisme est la projection. Mécanisme archaïque qui est retrouvé et identifié à la position schizoparanoïde décrite par M. Klein. La projection de la haine permet d’installer et de consolider la limite avec l’autre. La décharge projective se produit chaque fois que l’état limite lorsque, après un débordement, les mouvements pulsionnels ne trouvent plus les ressources internes nécessaires.Les limites du moi, chez l’état limite, existent bordés de mécanismes de défense tels que déni, clivage, projection, identification projective qui aident le sujet à entrer dans un mode hyperadaptatif, très collé à la réalité externe et des moments hyperprojectifs où cette même réalité est déformée, interprétée de façon excessive et effrénée sans aucun compromis.
De la question du sexuel. Le masochisme.
L’état limite se retrouve à l’Œdipe dans un mouvement sexuel clivé entre amour et haine. La dépendance vers le maternel, l’adaptation masquant la violence pulsionnelle. La problématique narcissique de l’état limite offre, écrit C. Chabert, l’organisation masochique de l’état limite. La perversion de l’enfant perdure après l’Œdipe et c’est ce qui va déclencher sons sentiment de culpabilité. Pour parler du masochisme, C. Chabert s’appuie sur les écrits de Freud « un enfant est battu » (1919). Chez certains patients état limite le phantasme de l’enfant est battu n’est pas totalement refoulé. C’est ainsi qu’elle présuppose que ce phantasme réapparaît sous forme de répétition, sous forme de conduite alimentaire addictive, ou autodestructive.La conduite autodestructive est une conduite de retournement contre soi, un débordement pulsionnel qui n’est plus étayé par les ressources internes du moi, c’est-à-dire les mécanismes inconscients du moi cités plus haut.Si le complexe d’Œdipe, une fois surmonté permet l’intégration de la conscience morale, c’est-à-dire du surmoi, il apparaît que pour l’état limite la conscience morale est dissociée de la tentation de transgression. Ainsi, écrit C. Chabert la conscience morale est externe au sujet et le phantasme de transgression persiste. On retrouve ici un clivage qui ne permet pas le refoulement que produit le dépassement de l’Œdipe par l’intégration de la haine.
La réaction thérapeutique négative.
C. Chabert pose la question sur la réaction thérapeutique négative fréquente chez les états limite comme une tentative de desobjectivation du lien tissé avec l’objet dans la cure analytique. La situation étant que la relation reste stérile pour que le travail commun analysant/analyste ne puisse se révéler : « une annulation des effets positifs ». Il s’agit ici de garder l’effet du mauvais objet devant ce qui pourrait être interprété inconsciemment par le sujet comme une tentative de séduction à son égard issue de la relation thérapeutique. Il s’agit pour le sujet d’une réaction régressive préservant ainsi l’attachement à l’objet maternel absent et ressenti comme mauvais, évitant ainsi toute action transférentielle et risquant une modification psychique de la représentation.Notons l’importance de l’opération transférentielle de la cure qui viendrait modifier la représentation archaïque du sujet et qui viendrait mettre en cause le clivage, le déni, le rejet. Comprenons que la réussite de la cure implique la séparation à l’analyste.Notons « c’est grâce à l’aggravation de leur état et à la douleur qu’elle entretient que cet agrippement est maintenu. » Le maintien de l’absence de l’objet provoque une douleur psychique et conduit à la compulsion de répétition vers une opération anobjectal « par la prévalence des pulsions et du masochisme primaire ».La douleur psychique éprouvée par le sujet devient le constituant de l’espace transitionnel créé en séance. L’expression de la douleur en présence de l’objet analyste devient le possible développement de la capacité de souffrir en présence de l’autre. L’autre qui est l’analyste par l’opération transférentielle conduit à la possible individuation. Dans ce cas l’autre n’est pas porteur des menaces d’empiétement et d’intrusion dont il était archaïquement le représentant.
Alain Giraud