" DEUIL ET MELANCOLIE " S. FREUD
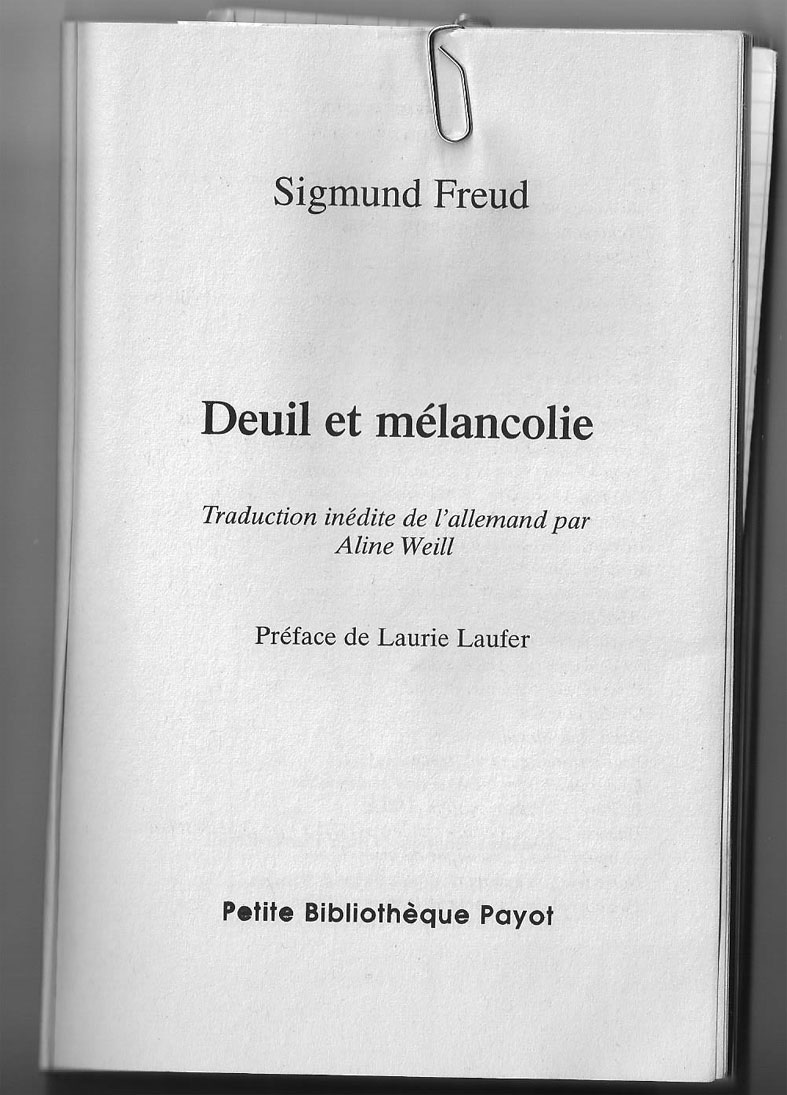
DEUIL ET MELANCOLIE – S. FREUD. PBP Edt. 2001
DEUIL ET MELANCOLIE
En 1917, Freud nous fait participer à la progression de sa réflexion pour distinguer ce qu’il différencie du deuil de la mélancolie et de son processus. L’année suivante Karl ABRAHAM discute du caractère de l’ambivalence de la mélancolie énoncé par FREUD dans Perte deuil et introjection
Pour FREUD, Caractéristiques de la mélancolie
« Psychiquement, la mélancolie se caractérise par une humeur profondément douloureuse, un désintérêt pour le monde extérieur, la perte de la faculté d’amour, l’inhibition de toute activité et une autodépréciation s’exprime par des reproches et des injures envers soi-même et qui va jusqu’à l’attente délirante du châtiment.]…[le deuil présente les mêmes caractéristiques, à l’exception d’une seule : l’autodépréciation morbide.] » (P45-46)
L’investissement libidinal
Le deuil et la mélancolie ont parmi leurs points communs décris par Freud celui de l’investissement libidinal dont l’individu à la difficulté à se séparer. Tout réside dans le travail que l’individu a à faire « de soustraire toute sa libido de ses attachements à l’objet » (P47) qui serait freiné par le désir. Quand Freud nous parle de résistance au principe de réalité, il évoque « la psychose hallucinatoire de désir ». Néanmoins même si le travail du deuil arrive à sa résolution, « l’objet perdu est conservé dans le psychisme » (P48). Il est intéressant de lire que le processus du deuil de l’objet peut se faire par un surinvestissement émotionnel, « souvenirs et espoirs », pour que le sujet soit en capacité de s’en séparer. La différence entre le deuil et la mélancolie est énoncée par l’objet investi : dans l’une la perte consciente de l’objet pour le deuil et l’inconscience de ce qui a été perdu concernant la mélancolie. Il approfondie en disant « Ce pourrait être même le cas lorsque la perte à l’origine de la mélancolie est connue du malade, lequel sait, à vrai dire, qu’il a perdu, mais pas ce qu’il a perdu dans cette personne. » (P49)
Retournement contre soi
L’objet dans le deuil provoque un appauvrissement de l’extérieur et l’objet introjecté dans la mélancolie provoque un appauvrissement du moi conduisant à une autodépréciation. Le retournement contre soi dans le cas de la mélancolie pourrait être un désir inconscient d’anéantir l’objet du deuil introjecté. Freud dit à ce propos : «… tout ce qu’ils disent de dépréciatif sur eux-mêmes se rapporte, au fond à autrui. » (P55)
L’identification à l’objet introjecté
Nous constatons qu’en cas de mélancolie, l’investissement libidinal se trouvant libéré, de par la perte de l’objet, celui-ci est à la recherche d’un autre port d’attache qui devient le moi : le déplacement n’a pas pu s’effectuer vers l’extérieur mais bien vers l’intérieur, au sein du moi. Page 56, S. FREUD nous parle d’identification du moi avec l’objet perdu, abandonné, « l’ombre de l’objet est ainsi tombé sur le moi » : Il existe alors un moi scindé en deux parties l’une critique du moi, et l’autre identifié à l’objet perdu. Il rajoute qu’il existe, dans la mélancolie, une prédisposition narcissique dans le processus d’identification au choix d’objet au même titre que dans les névroses de transfert. De ce fait il fait l’hypothèse que les névroses de transferts tels que l’hystérie et la névrose obsessionnelle seraient alors un mécanisme de défense contre la perte de l’identification à l’objet perdu dont l’investissement serait un substitut de l’investissement érotique primaire. De ce fait il dit « L’investissement libidinal du mélancolique pour son objet a connu ainsi un double destin : il a régressé en partie au stade de l’identification, mais pour le reste, sous l’influence du conflit d’ambivalence, il a été ramené à la phase sadique qui est proche de lui. » (P62)
La mélancolie et la tendance suicidaire
À propos de la mélancolie et de la tendance suicidaire Freud fait le lien avec le stade anal en incluant l’effet du sadisme contre le moi lui-même. L’objet extérieur n’existe plus, comme dans les névroses de transfert même si chacun d’eux est dans une souffrance du moi, il s’agit d’un retournement pulsionnel contre le moi lui-même qui se considère inconsciemment comme l’objet. Il dit « Nous sommes alors tentés d’admettre qu’une caractéristique marquante de la mélancolie, la portée de l’angoisse d’appauvrissement, dériverait de l’érotisme anal arraché à ses liens initiaux et transformé de manière régressive. » (P63)
L’ambivalence dans la mélancolie
Il apparaît que l’objet introjecté subit les assauts pulsionnels « l’un pour détacher la libido de celui-ci, l’autre pour défendre sa position libidinale contre l’assaut de la haine. Pour Freud les trois conditions de la mélancolie sont « la perte de l’objet, l’ambivalence et la régression de la libido dans le moi, nous retrouvons les deux premières dans les reproches compulsifs exprimés après les décès. » (P75)
PERTE DEUIL ET INTROJECTION - Karl ABRAHAM
Suite au travail de Freud sur le deuil et la mélancolie, Karl ABRAHAM explore plus avant la mélancolie et notamment le caractère de l’ambivalence énoncé par Freud. Dans les deux cas, il nous dit que l’objet est introjecté par le sujet. La différence résiderait pour lui dans la capacité économique du moi à gérer l’objet investit en abordant les sujets de l’introjection et de l’incorporation. « L’introjection mélancolique survient sur la base d’une perturbation fondamentale de la relation libidinale à l’objet. Elle est l’expression d’un conflit ambivalentiel dont le moi ne parvient pas à se retrancher qu’en prenant à son compte l’hostilité concernant l’objet. » (P87-88) « Le conflit d’ambivalence de la libido est si grave que tout sentiment d’amour est immédiatement menacé de son inverse. Une quelconque défaillance, une déception par l’objet d’amour favorise quelque jour une vague de haine qui submerge les sentiments d’amour trop faible. La perte de l’investissement positif conduit ici à une conséquence majeure : au renoncement à l’objet. » (P93)
Alain Giraud