"ATTACHEMENT ET PERTE" John Bowlby - Edition puf - 5ème edition 2002
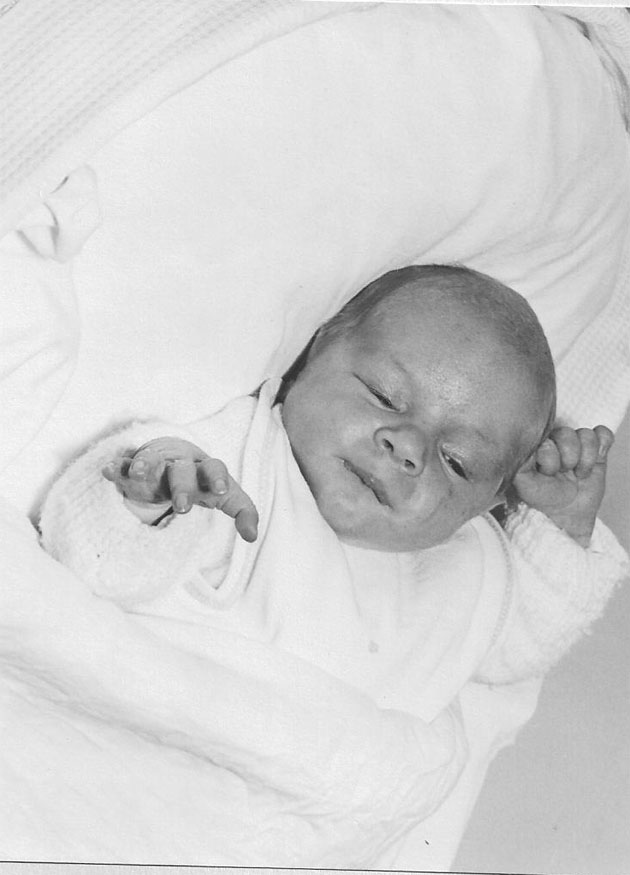
Fiche lecture "LE LIEN D'ATTACHEMENT A SA MERE : LE COMPORTEMENT D'ATTACHEMENT" (chapitre 11)- John Bowlby « ATTACHEMENT ET PERTE » - éditions puf 5ème edition 2002- 1er edt. 1978
LE LIEN D'ATTACHEMENT A SA MERE : LE COMPORTEMENT D'ATTACHEMENT(Chapitre 11)
Le comportement de l’attachement
Son point de départ est 1958 et « les quatre théories principales concernant la nature et l’origine du lien de l’enfant » : « La théorie de la tendance secondaire », « la théorie de la succion primaire de l’objet », «la théorie de l’agrippement primaire à l’objet » et « la théorie du retour primaire au ventre maternel ». A ce propos, la description de J. Bowlby rappelle les composantes du holding, du handing, de l’objet presenting, de l’espace transférentiel. Il relève que celle qui présente plus d’intérêt sans écarter les autres est celle de l’apprentissage qui est contenu par la théorie de la tendance secondaire. Il envisage sa théorie (de l’attachement) par l’idée suivante : « le lien de l’enfant à sa mère est le produit de l’activité d’un certains nombres de systèmes comportementaux qui ont pour résultat prévisible la proximité de l’enfant par rapport à sa mère » (p247). Il poursuit en développant son étude à propos du développement des systèmes comportementaux qui selon lui sont en interaction à la fois avec la mère mais aussi l’environnement tout en soulignant qu’il admet que les théories les plus proche de la sienne sont la théorie de la succion de l’objet et celle de l’agrippement à l’objet. L’idée de l’objet qui est à la fois la mère faisant partie de l’environnement. Il est intéressant de remarquer qu’en page 249 il signale que ce qui fait la proximité à la mère repose sur les cinq schèmes qu’il avait précédemment décrit : « La succion, l’agrippement, le comportement de suivre, les pleurs et le sourire »
Attachement chez l'animal
Pour parler de l’attachement il compare l’attitude des mammifères en prenant pour exemple entre autres les singes et l’humain. L’étude sur laquelle se base J. Bowlby est autant passionnante que minutieuse. Il existe une analogie entre l’enfant animal et l’enfant humain de 0 et 3 ans. Bien entendu les variantes de développement psychique et moteur sont différentes et on peut remarquer la rapidité de développement chez l’enfant animal, néanmoins il existe de nombreux points concomitants qui interpellent. De l’étude il identifie que « toute forme de comportement juvénile qui aboutit à la proximité peut être considéré comme une composante du comportement d’attachement » (P251) Que ce soit animal ou humain le comportement d’attachement est toujours dirigé vers la figure maternelle et que c’est seulement à l’adolescence qu’il leur arrive de s’éloigner de la mère. J. Bowlby conclue à partir des comptes rendus que d’une part « les jeunes primates de toutes espèces s’accrochent aux objets avec la plus grande ténacité » (P261) que c’est en une semaine qu’il identifie la figure d’attachement et que c’est vers elle que l’enfant animal se réfugie lorsque l’alarme retentie et que la nature de la figure à laquelle l’attachement se produit à un effet sur le développement de l’individu.
Attachement chez l’humain
Concernant le comportement du petit enfant et du parent, J. Bowlby souligne que « ce n’est que dans les sociétés humaines plus développés sur le plan économique et principalement dans les sociétés occidentales que les enfants sont couramment hors de contact avec la mère pendant plusieurs heures du jour et souvent au cours de la nuit aussi ». Il distingue une différence notoire entre l’humain et le singe rhésus concernant la théorie de l’agrippement : le premier ne s’agrippant fermement que quand il identifie la mère alors que le second le fait avant cette « identification » (terme que j’emploie sciemment car je pose comme l’hypothèse que c’est grâce à l’identification inconsciente du corps de l’enfant à celui de la mère que l’agrippement peut se déclarer plus fermement, comme une action fusionnelle. Et c’est sur cette distinction que J. Bowlby réfléchit pour répondre à sa question « comment décider quelles sont les critères qui permettent de juger le début du comportement d’attachement chez l’homme ? »
Le développement du comportement d’attachement
De la première à la deuxième année
Les études faites lui permettent de dire qu’a partir de quatre mois, l’enfant répond à la figure maternelle en souriant, vocalisant et en la suivant des yeux. Néanmoins il n’identifie pas de comportement soulignant l’identification de la mère et le maintien de la proximité avec elle. John Bowlby élargit son étude comparative en mettant en relief des enfants africains d’Ouganda et des enfants Anglais, Ecossais et Américains.
Le comportement « de pleurer et de suivre » est déjà présent chez les enfants Ougandais à 4 mois environ. Il remarque que chez ses enfants le comportement d’attachement est confirmé à l’âge de 6 mois par des comportements de pleurs lorsque la mère quitte la pièce mais aussi de fête lors de son retour (p274). Le comportement d’attachement se consolide entre 6 et 9 mois et le développement psychomoteur de l’enfant permet à ce dernier de mettre en fonction « le suivre ». Cela favorise la fonction d’agrippement à la mère qui répond également au besoin de protection lorsque l’enfant est apeuré par un événement comme la présence de l’étranger à l’environnement. Par contre souligne-t-il à partir de l’âge de 9 mois l’enfant est capable de suivre u individu familier de l’environnement en l’absence de la mère.
Concernant l’étude faite à partir des enfant Ecossais, le comportement d’attachement est identifié et réparti entre 6 et 9 mois et note un développement plus lent en comparaison aux enfants Ougandais. C’est à 18 mois que le comportement d’attachement est réellement identifié vers des individus autres que la mère, tels que père et ainé(s) (p276). Il est intéressant de dire que l’intérêt pour d’autres figures ne semble pas altérer l’intensité de l’intérêt pour la mère.
Les variables intervenant dans l’attachement
Les deux variables intervenant dans le rythme du comportement d’attachement sont les variables organismiques (faim, fatigue, maladie, chagrin) et les variables environnementales qui sont surtout identifiées par l’apparition du danger. La similitude entre humain et animal est à noter : « … toutes les variables rapportées comme influençant à court terme l’intensité de l’attachement chez les enfants humains sont les mêmes que celles rapportées comme influençant son intensité à court terme chez les petits des singes et des grands singes. » (P278)
Je sous-entends un corollaire avec les avancées de Winnicott et je comprends les idées du holding et handing dans ce qui suit : « Même s’il y a beaucoup de signes montrant que le type de soins que reçoit un enfant de sa mère joue un rôle capital pour déterminer la façon dont son comportement d’attachement se développe, il ne faut jamais oublier que la mesure dans laquelle l’enfant lui-même prend l’initiative de l’interaction et influence la forme que cela prend. » (P278) On pourrait accorder à ce que dit Bowlby le concept de Bion et la nécessité de l’interaction de la capacité de rêverie de la figure maternelle. A ce sujet J. Bowlby relève l’influence interactive des comportements enfant et mère dans les exigences de celui-ci et les réponses de celle-ci. (P279)
De la deuxième à la troisième année
L’auteur remarque un changement qui s’ajoute à ce qui est acquis qui est le développement perceptuel qui élargit les perceptions environnementales de l’enfant qui influent sur son comportement d’attachement. Il est remarqué que c’est après avoir quitté son activité que l’enfant remarque l’absence visuelle de la mère dans son environnement et manifeste ensuite son mécontentement. (P279) Je peux faire l’hypothèse dans ce cas d’une similitude avec des résidus du phantasme d’engloutissement apparaissant juste après la période de sevrage psychique. De fait il est intéressant de faire un parallèle avec les recherches de Mélanie Klein et des différents phantasmes inscrits durant ce qu’elle appelle la période dépressive et ce que Winnicott signifie comme la période de l’attente. C’est à 11 ou 12 mois, nous dit J. Bowlby, que l’enfant est en capacité de prévoir le départ de la mère, c’est-à-dire pendant le phantasme de translation. On remarque la capacité d’anticipation qui pourrait être dû à l’acceptation psychique de la séparation, en voie de développement, durant cette période.
Après la troisième année
L’attachement sera « manifesté avec violence et régularité jusque presque à la fin de la troisième année » (P279). C’est à la troisième année que d’après son étude, Bowlby signale un détachement plus notoire chez l’enfant qui acceptera l’absence de la mère, sous conditions d’y être préparer, au profit de son activité en cours et des figures connexes et « familières ».
de la cinquième à la sixième année et période de latence
Durant cette période et celle de Latence, J. Bowlby identifie le besoin de l’enfant d’être en contact ( la main) avec le parent ou « substitut familial »et encore plus pour être rassuré face à un danger : « Ainsi pendant toute la période de latence d’un enfant ordinaire, le comportement d’attachement continue d’être un trait dominant de sa vie » ( P282).
La phase de l’Adolescence et de l’adulte
Durant cette période dite de l’adolescence J. Bowlby signale que l’attachement aux parents diminue et est transféré vers l’extérieur influencé par la dominante de « l’attirance sexuelle ». Néanmoins, trois variables sont identifiées : « A un extrême il y a les adolescents qui se coupent des parents ; à l’autre extrême ceux qui restent attachés et sont incapables ou refusent de diriger leur comportement d’attachement vers d’autres ; entre ces deux extrêmes, il y a la grande majorité des adolescents dont l’attachement à l’égard des parents reste puissant mais dont les liens à d’autres ont aussi beaucoup d’importance » (P282). L’auteur nous montre qu’il y a transfert de l’attachement de l’enfance vers des organisations, lieux professionnels, des comités, des personnes, état et politique, dont les critères appartiennent à l’individu mais où le besoin de la figure dominante reste présent. Je peux faire l’hypothèse que si l’attachement dans la vie de l’adulte résulte du développement de l’attachement alors les fragilités névrotiques résultent aussi d’une problématique d’attachement que l’on peut repérer par les points de fixation.
Interaction et effets
Bowlby détermine cinq réactions « médiatisant » l’attachement tout en distinguant que les pleurs et le sourire amènent la mère vers l’enfant, le comportement de suivre et l’agrippement induit la posture de l’enfant vers la mère, et l’appel par les cris ou le nom.
Le sentiment
J. Bowlby convient que le sentiment d’amour est contenu dans le comportement d’attachement « les figures vers lesquelles il est dirigé (l’attachement) sont aimés et leur venue est accueillie avec joie » (P285). De ce fait toute menace de perte de la figure d’attachement va provoquer des comportements d’angoisse, de chagrin, de colère. Je remarque ici les premières étapes du deuil dans la difficulté de l’acceptation à sa séparation du lien d’attachement.
Alain Giraud