Fiche de lecture "GÉNÈSE ET SITUATION DES ÉTATS LIMITES" 1999, André Green, Petite bibliothèque de psychanalyse,Puf
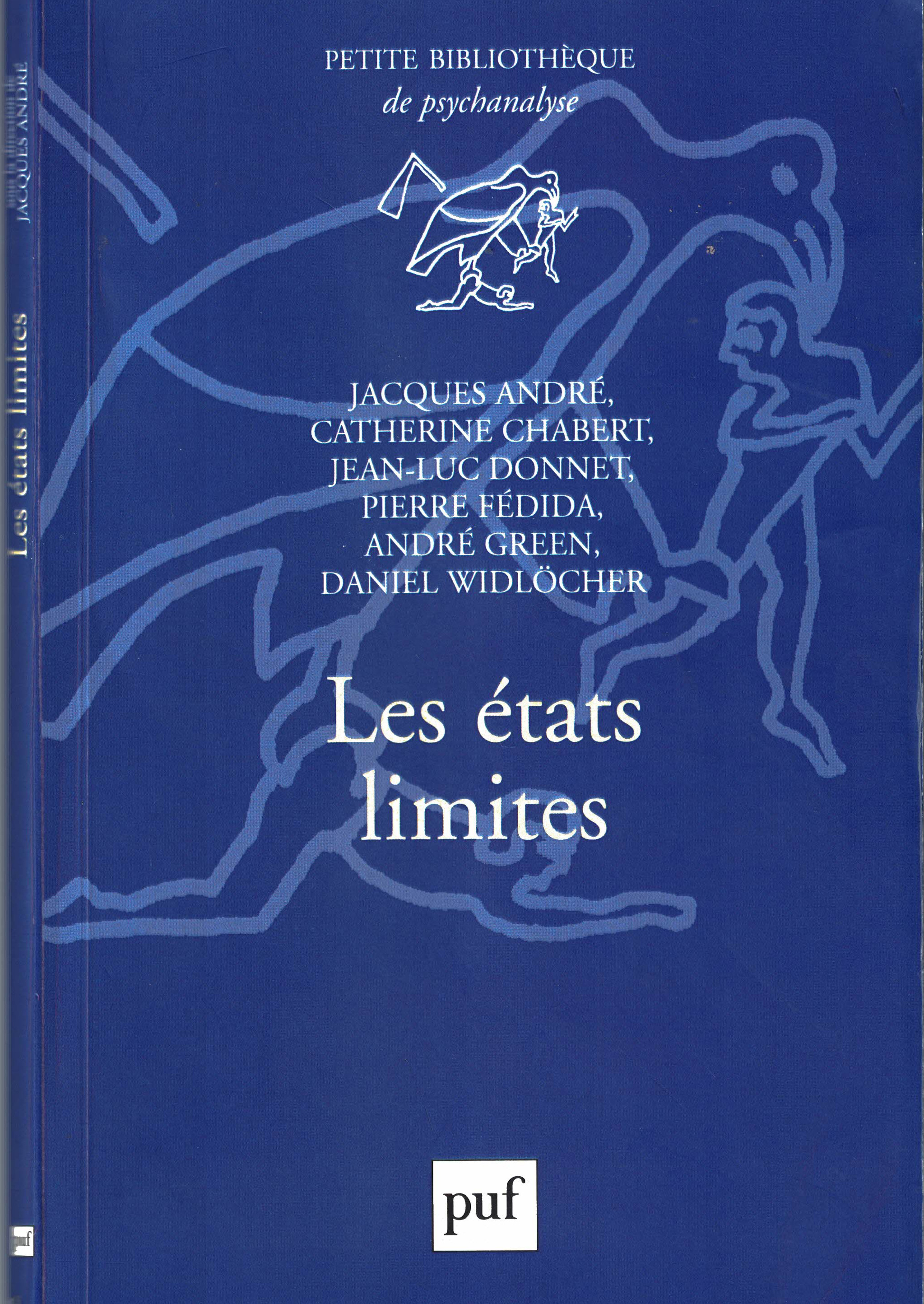
I
A. Green fait référence aux travaux de Ferenczi concernant « le trauma qui n’est pas toujours en rapport avec ce qui a eu lieu, mais aussi avec ce qui n’a pas eu lieu ». En d’autres termes, la non-réponse de l’objet primaire peut avoir des conséquences graves qui « paralysent l’activité du moi ». En 1924, c’est en différenciant psychose et névrose que Freud reconnaît l’existence des traumas archaïques laissant des cicatrices. Il a parlé de « la folie des hommes », nous dit A. Green, et se réfère au clivage du moi. Freud introduit le clivage en termes de séparation et non d’annulation à la différence de la conception Kleinienne. En 1927 (le fétichisme) Freud distingue deux systèmes : la perception et la reconnaissance. Il s’intéresse aux rapports entre le clivage et le moi et son œuvre « se clôt sur le clivage du moi dans le processus de défense. » Puisque Freud s’intéressait aux psychoses de transfert, Green se réfère d’une part au « transfert de la libido corporelle sur la libido psychique » et d’autre part « le transfert d’un objet du passé sur un autre objet du présent, l’analyste ».
Dans sa première topique tout comme dans la seconde Freud a défini la limite comme une zone d’élaboration psychique. A. Green rappelle ce qui n’a pas été abordé, c’est-à-dire « la théorie des relations d’objet ». Il pose la limite comme un concept à la limite entre le psychisme et le somatique. En ce sens la limite est un espace de transition au même titre que ce que Freud a pu décrire : les limites entre les différentes instances psychiques de la deuxième topique. L’appareil psychique a des limites qui sont des zones d’élaboration intrapsychique et en relation avec deux objets : L’objet dans le moi et L’objet extérieur. C’est la relation entre les deux qui définit la conception de l’objet tout en considérant que le moi a deux angoisses, celle de la séparation et celle de l’intrusion, c’est ce qui concerne particulièrement le borderline.
Chez les borderlines, il existe deux grandes sensibilités, celle de la porosité à l’émotion de l’objet externe et celle de l’intrusion. La conception de l’objet est donc d’une grande importance et c’est pour cette raison, nous dit A. Green, que la grande souffrance du borderline est le désert objectal. Par conséquent la référence à l’espace transitionnel de Winnicott, où siège l’objet, a toute son importance. L’espace potentiel devient une zone limite d’élaboration ou peut se travailler la symbolisation. L’angoisse de castration de la névrose est comparable à l’angoisse de séparation chez les états limites ainsi que l’angoisse de pénétration chez le féminin l’est à l’angoisse d’intrusion chez le borderline.
II
Différence entre névrose et cas limite.
Les traits qui caractérisent névrose grave et état limite ne sont pas si simples à différencier. Pour Green, toutes les névroses sont graves au sens où elles représentent et renferment une pathologie psychique. Les limites se caractérisent par d’autres traits spécifiques. Il récuse la position Kleinienne au sujet du noyau psychotique, il pense et dit que névrose ou névrose grave ne révèle pas automatiquement la présence d’un noyau psychotique, une psychose infantile, mais « relèvent plutôt d’une désorganisation névrotique plus complexe.» Après au-delà du principe de plaisir, Freud convient que certaines structures ne sont pas gouvernées par le principe plaisir/déplaisir. Bien au contraire, une forme de stagnation créée par la compulsion de répétition. En d’autres termes « la remémoration cède la place à l’actualisation. »
A. Green fait la différence entre névrose grave et état limite. Il identifie la névrose grave par « la ténacité des fixations, faible mobilisation des symptômes par l’analyse, transformation limitée par l‘analyse des transferts, rigidité des mécanismes de défense, transfert peu massif, peu nuancé, et ne se modifie pas pendant la cure. » Concernant la névrose obsessionnelle, elle est d’une plus grande clarté par la lisibilité des processus inconscients, les modes défensifs d’organisation du moi, les fixations qui apparaissent dans le matériel, ténacité des fixations orales qui sont rigides, les bénéfices prégénitaux sur le mode sado-masochique sont difficiles à lever, difficulté d’accès au mode génital. Les mécanismes sont l’isolation des affects, l’annulation rétroactive et formation réactionnelle.
A. Green nous rappelle que les travaux de Freud mettaient en question le désir lié aux représentations eux-mêmes liées à l’inconscient et à l’agir, la motion pulsionnelle liée au passage à l’acte, à la répétition, liée au ça. Ainsi la 2ème topique a permis, dans les recherches de Freud, de différencier les répétitions de l’agir. Il dit à ce propos « la motion pulsionnelle renvoie à la décharge aveugle et irrémédiable dans le but de soulager l’appareil psychique, ce qui ne revient pas à une référence au plaisir mais à la sauvegarde minimale de la liaison psychique primaire.Le dilemme est entre la motion pulsionnelle cherchant la décharge et/ou une représentation de chose." Les structures limites ont tendance à la répétition, nous dit A. Green, à l’agir, à la désorganisation du moi. Freud dans la deuxième topique a indiqué le caractère hétérogène qui induit la confrontation entre un ça pulsionnel et le surmoi culture.
L'objet
A. Green soulève la problématique de l’objet différente chez le névrosé et chez l’état limite. Alors que pour le premier l’objet est fantasmatique, celui des désirs inconscients, de prohibition et des interdits, pour l’état limite l’objet peut se manifester à la place du sujet lui-même : « Ce qui apparaît chez un patient névrotique comme de l’ordre de l’identification devient chez ce patient de l’ordre de la confusion identitaire. » Après avoir abordé l’hallucination négative de la pensée, l’auteur aborde celle du miroir. Le problème de la perception sensorielle s’impose par ces phénomènes, tout comme le langage qui semble être en relation direct avec l’inconscient sans pour autant être du domaine du lapsus ou autres mots d’esprit. Green interpelle également le lecteur sur l’aspect hypocondriaque du sujet limite balançant dans une forme de chantage entre risque de somatisation et décompensation.
Le borderline de type hystérique
Il est au-delà de la névrose : accès boulimique, mécanismes addictifs, retrait social, minimisation du genre masculin, distanciation dans les relations amicales, excellence professionnelle, moment de dépression. Les tentatives de suicides sont associées à la décharge pulsionnelle qui permet de s’extraire de la réalité où il est difficile de couper avec les affects douloureux. Le futur semble difficile à envisager et provoque une intemporalité. Pour ces patients l’interprétation est difficilement perceptible dès lors qu’elle touche, dans sa deuxième phase, au noyau conflictuel. Une forme d’incompréhension se fait jour, une hallucination négative de la parole. Au sujet du rêve, celui-ci a valeur d’évacuation sans mobilisation interne du sujet. L’activité pulsionnelle de l’état limite versant hystérique ne permet pas d’élaboration psychique : « ce sont des noyaux bruts qui à un certain moment se déchargent et qu’il n’est pas possible de relier ou d’établir les liens qui leur donneraient le sens qu’aurait chez un névrosé un désir inconscient. »
Le borderline de type obsessionnel
L’investissement de la pensée est considérable dont la forme, nous dit A. Green, est intermédiaire entre névrose obsessionnelle et paranoïa, sentiment de persécution par l’entourage, satisfaction du masochisme, rapport de force, victimisation, sentiment de rejet, autopersécution intense. Obstination vers le parfait et l’échec pour rester dans l’imparfait de soi. « Fixation anale primaire où la régression atteint le narcissisme. » Les patients limites dont la structure est obsessionnelle souffrent d’une persécution interne importante. Les réalisations, professionnelles par exemple, ne doivent souffrir d’aucune imperfection car le sujet se confond considérablement avec elles et sont vouées bien évidemment à l’échec.
Cadre analytique
André Green termine sa conférence en disant que la folie privée de l’état limite « ne peut se manifester vraiment dans toute son ampleur qu’avec les conditions facilitantes du cadre analytique, un cadre analytique favorablement réceptif à leur régression. » Contrairement à ce que dit Jacques André, Green ne pense pas que la parole guérit par l’apaisement. Cependant quelques fois il considère comme important de sortir du cadre interprétatif dont la stratégie reste favorable pour ces patients. Il se réfère à l’honnêteté de Searles lorsqu’il évoque l’expression des affects contre-transférentiels qui produit des résultats surprenants, puis Winnicott et de la haine dans le contre-transfert. Pour finir, le transfert chez l’état limite est un mode communicationnel qui permet au sujet limite de faire éprouver à l’analyste ce qu’il ne peut éprouver de lui-même.
Alain Giraud